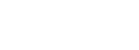Nouvelles
2 mai 2020
Europe : La crise de la COVID-19 pourrait-elle contribuer à la relocalisation de la production ?
Depuis quelques semaines, en France, on entend de plus en plus fréquemment le mot « relocalisation », dans les conversations et les débats.
C’est sans doute parce que nous avons pris davantage conscience, à l’occasion de la crise de la COVID-19, des conséquences de la délocalisation de la production. La crise actuelle nous a amenés à constater avec douleur notre forte dépendance à l’égard de l’étranger, en particulier de la Chine, de l’Inde ou des États-Unis, pour ce qui concerne notre matériel médical, nos médicaments et nos vaccins, notamment. Elle nous a également poussés, dans le domaine de l’alimentation, à nous inquiéter du poids considérable des fruits et légumes et de certains ingrédients essentiels pour nourrir nos animaux d’élevage en provenance de l’étranger et dont les importations sont freinées par les restrictions imposées aux frontières. Ce qui est vrai pour la France est aussi valable pour un grand nombre de pays en Europe et ailleurs.

Ce constat fait que quand les politiques, les experts et les journalistes nous parlent de l’« après-crise de la COVID-19 », ils entonnent très souvent le refrain de la relocalisation. Ils nous disent qu’il va falloir relocaliser la production chez nous et que cela ne manquera pas de survenir dans un avenir proche.
Mais que signifierait la relocalisation ? Quelles en seraient les conséquences ? Et quels sont les principaux obstacles d’un mouvement qui pour beaucoup semble être une solution à plusieurs de nos maux ? C’est ce que ce court article envisage d’explorer sans pour autant rentrer dans des détails trop techniques.
La relocalisation nous est donc fréquemment présentée aujourd’hui comme une nouvelle panacée, la source d’une souveraineté renouvelée qui nous permettrait d’être plus forts, de créer des emplois et de réduire nos émissions de gaz à effets de serre (réduction du transport oblige) et par conséquent de lutter contre le dérèglement du climat qui était l’une de nos préoccupations majeures avant l’apparition du virus. Bref, la merveilleuse relocalisation nous promettrait des jours meilleurs. Il y a bien ça et là quelques importuns qui expliquent à qui veut bien les entendre que la relocalisation aurait pour conséquence une hausse probable des prix… À quoi, ses promoteurs répondent que quand il s’agit de souveraineté, le prix importe peu.
Et pourtant…
Relocalisation et délocalisation
Par relocalisation, on entend se remettre à produire localement ce que l’on avait délocalisé dans le passé pour le faire ailleurs, à l’étranger. L’argument principal en faveur des délocalisations a toujours été l’efficacité économique et la baisse des prix qu’elle est censée entraîner. C’est l’argument que l’on utilise pour expliquer les avantages économiques retirés du commerce. Rappelons ici que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les échanges internationaux ont connu une expansion extraordinaire qui s’est faite à un rythme bien supérieur à celui de la croissance économique mondiale : entre 1948 et 2013, leur volume fut multiplié par 300 ! [lire]
Si l’on considère, en les complétant, les informations pratiques préparées à l’intention des chefs d’entreprises [lire], on peut affirmer que nos firmes ont décidé de délocaliser pour :
-
•pour réduire leurs coûts, surtout leurs coûts de production : on choisit de s’établir dans un pays :
-
-
•où les salaires et les cotisations sociales sont moins élevés (car il n’y a pas ou peu de protection sociale pour sa main-d’œuvre) ;
-
•où la législation du travail est plus souple (durée du travail, normes de sécurité et flexibilité à l’embauche et au licenciement) ; et,
-
•où les normes et réglementations environnementales permettent d’utiliser des technologies polluantes qui sont interdites (ou taxées) chez nous.
-
-
•pour profiter d’une fiscalité plus basse, notamment en ce qui concerne les taxes sur les profits ;
-
•bref, pour bénéficier des conditions les plus favorables aux affaires.
La recherche de contrées offrant le contexte le plus avantageux a abouti, au niveau mondial, à une compétition généralisée entre pays en quête d’investisseurs qui a contribué au nivellement vers le bas des normes sociales et environnementales que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ailleurs [lire p.8].
La volonté de se rapprocher d’un marché ou de la source de matières premières volumineuses qu’il est coûteux de transporter avant transformation, peut également parfois justifier ce mouvement.
Il est intéressant de noter qu’au cours de ces dernières années, bien avant la crise de la COVID-19, on a pu observer un début de tendance à la relocalisation. Elle a souvent été expliquée par l’instabilité politique, l’insécurité économique ou la pauvreté des services proposés dans les pays où l’on avait délocalisé, et par la force du « fabriqué en France » comme argument de vente dans la mesure où il est devenu synonyme de qualité et de soutien au nationalisme économique.
On peut déduire de tout cela qu’une relocalisation de la production reviendrait, à technologie constante, à produire plus cher et donc à vendre plus cher, toutes choses égales par ailleurs.
Et si l’on relocalisait la production, que se passerait-il ?
Il est clair de ce qui vient d’être dit qu’un retour de la production impliquerait des coûts et par conséquent un prix de vente plus élevés pour les produits relocalisés, à moins que :
-
•la relocalisation soit accompagnée d’un changement de technologie (comme la numérisation observée dans l’habillement) ;
-
•les entreprises soient prêtes à investir des capitaux pour travailler en faisant moins de profits. (Cette seconde hypothèse paraît cependant peu crédible, à moins qu’elles soient soumises à des pressions politiques) ;
-
•que nos gouvernements décident de mettre en œuvre des politiques typiques visant à améliorer notre compétitivité, telles que la réduction des taxes sur les profits et le coût du travail (en diminuant les cotisations sociales) : cela entraînerait alors l’affaiblissement du système de protection sociale en place dans le pays où la relocalisation s’effectue, et ce pays participerait donc de manière accrue à la compétition économique internationale. Cette option est vue d’un bon œil par certains dans les milieux patronaux.
En l’absence de telles transformations, la hausse des prix qui découlerait d’une relocalisation pourrait sans doute être absorbée par les consommateurs les plus riches. Pour eux, la qualité vantée des produits locaux, l’intérêt national et, dans certains cas, l’argument environnemental, pourraient suffire pour qu’ils acceptent d’acheter plus cher. C’est ce que l’on observe déjà dans le domaine alimentaire où les classes aisées préfèrent payer plus cher les fraises françaises (au lieu de fraises espagnoles au goût de sexe et de pesticides [lire]), l’agneau de Sisteron élevé sur les pâturages de Haute Provence plutôt que l’agneau en provenance de Nouvelle-Zélande, ou le bio français plutôt que l’italien, l’espagnol ou le marocain, les normes variant d’un pays à l’autre et étant réputées plus strictes en France.
Dans ce cas, la relocalisation contribuerait à une segmentation plus marquée du marché : la nourriture d’origine France « de qualité » allant aux riches, la nourriture importée, meilleur marché et de moindre qualité, aux pauvres.
Pour ce qui est de l’alimentation du bétail, par exemple, les conséquences ne se sentiraient pas seulement au niveau des prix, mais aussi dans la structuration des filières (une composition différente des aliments pour le bétail nécessiterait des changements dans la production locale en vue de développer les disponibilités en céréales ou en cultures protéagineuses fourragères pour remplacer par exemple le soja importé).
Dans toutes ces éventualités, cela créerait des emplois locaux (un argument fortement mis en avant par les partisans de la relocalisation), assurerait une sécurité stratégique et une souveraineté plus affirmée (la production étant contrôlée localement, la dépendance envers l’étranger s’en verrait réduite).
Les obstacles à la relocalisation
Les différences de coûts, de prix et de rentabilité, on le voit, peuvent constituer des obstacles à la relocalisation. Un argument supplémentaire pourrait être le refus d’entériner deux catégories de produits : ceux pour riches et ceux pour les pauvres.
En effet, il ne faut pas oublier que les biens issus de la production locale continueront de subir la compétition des importations et que beaucoup de consommateurs persisteront à acheter les produits étrangers moins chers pour sauvegarder leur pouvoir d’achat qui a fortement bénéficié de la mondialisation entre 1996 et 2010 [lire p.5 et suivantes]. La concurrence entre produits relocalisés et produits importés sera d’autant plus féroce qu’ils seront difficiles à différentier les uns des autres : il est moins facile de distinguer un cachet de paracétamol ou un respirateur chinois de ceux fabriqués en France, qu’il n’est aisé de faire la différence entre la fraise espagnole et sa cousine française. À moins, bien sûr, de faire un effort considérable sur l’information des consommateurs (logos, labels et autres indications) ou de nationaliser les entreprises concernées (dans le secteur industriel surtout, la production de médicaments, par exemple), ce qui permettrait, en ne prélevant pas les dividendes qui dans le privé reviendraient aux actionnaires, de leur verser une subvention indirecte et ainsi de contourner d’une certaine façon certains accords commerciaux. Une autre possibilité pourrait être de favoriser l’émergence de coopératives ouvrières de production.
En l’absence de changements technologiques, d’acceptation de réduire les profits ou de politiques de compétitivité au moment de la relocalisation, on pourrait, en théorie, rétablir l’équilibre entre les produits relocalisés et ceux importés en appliquant des taxes ou des subventions afin de les vendre tous au même prix, ce qui rendrait la production locale plus attractive pour les consommateurs pauvres. En réalité, de telles mesures paraissent inapplicables, car les engagements pris sur la réduction des taxes d’importation et des subventions dans le cadre de l’OMC ou des accords commerciaux bilatéraux excluent tout recours durable à des politiques « protectionnistes » de ce genre, sous peine de devoir payer des compensations, ou pire encore, d’avoir à subir des menaces de rétorsion qui pourraient frapper les produits d’exportations du pays qui les appliquerait (dans le cas de la France : armes, d’avions, articles de luxe, vins, spiritueux, etc.)*.
Dans ces conditions, les obstacles à la relocalisation ne pourraient être surmontés qu’après une remise en question des résultats de près de 70 années de négociations commerciales multilatérales qui, pour être contraignants et avoir poussé la libéralisation des échanges, n’en offrent pas moins maintenant une certaine protection aux pays les plus faibles [lire p. 4 et suivantes]. En effet, pour un État de taille moyenne ou petite, il est problématique de mener des négociations bilatérales avec des géants économiques tels que les États-Unis, l’Union européenne ou la Chine [lire]. Il suffit de prendre comme exemple les difficultés éprouvées par le Mexique lors de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) après l’élection de Trump.
Au vu de ces considérations, la réponse à la question de notre titre est qu’il est très probable que la relocalisation de la production restera limitée en volume, à moins d’un changement radical de règles du commerce international, du démantèlement du système économique mondial en place et/ou de mise en œuvre de politiques de compétitivité au prix d’une érosion de la protection sociale locale. En l’absence d’une telle transformation qui demeure cependant possible étant donné le contexte politique, la relocalisation risque de se limiter dans le domaine alimentaire à des produits bien individualisés du point de vue de la qualité (Bio ou conventionnel) ou de l’origine géographique (Appellations d’origine protégée, contrôlée ou géographique - AOP/AOC/IGP). Elle bénéficiera certainement également de la démultiplication d’initiatives locales prises dans le cadre de la transition agricole [lire]. Mais elle se fera probablement au prix d’une segmentation sociale accrue du marché. La douloureuse expérience de la crise du COVID-19 pourrait encourager un mouvement plus ample pour ce qui est de produits définis comme stratégiques, comme les médicaments, les vaccins et le matériel médical.
—————————
* Certains pourront contester ce point de vue, au moins dans le cas de l’OMC, dans la mesure où l’Organe de règlement des différends de l’OMC n’est plus véritablement opérationnel depuis fin 2019 puisqu’il ne comporte plus le minimum de trois membres, du fait du blocage, depuis 2017, des nominations par les États-Unis.
—————————————
Pour en savoir davantage :
-
•Pourquoi délocaliser son entreprise, Fiches pratiques, Chef d’entreprise, 2016.
-
•J.M. Caballero, M.G. Quieti et M. Maetz, Le commerce international: Quelques théories et concepts de base dans "Les Négociations Commerciales Multilatérales sur l’Agriculture - Manuel de Référence - I - Introduction et Sujets Généraux", FAO 2000.
-
•OMC, Accord sur l’Agriculture, Accords de Marrakech, 1994.
-
•OMC, Agriculture: des marchés plus équitables pour les agriculteurs, site web.
Sélection de quelques articles parus sur lafaimexpliquee.org liés à ce sujet :
Dernière actualisation : mai 2020
Pour vos commentaires et réactions : lafaimexpl@gmail.com